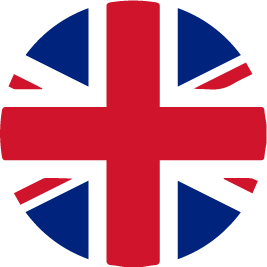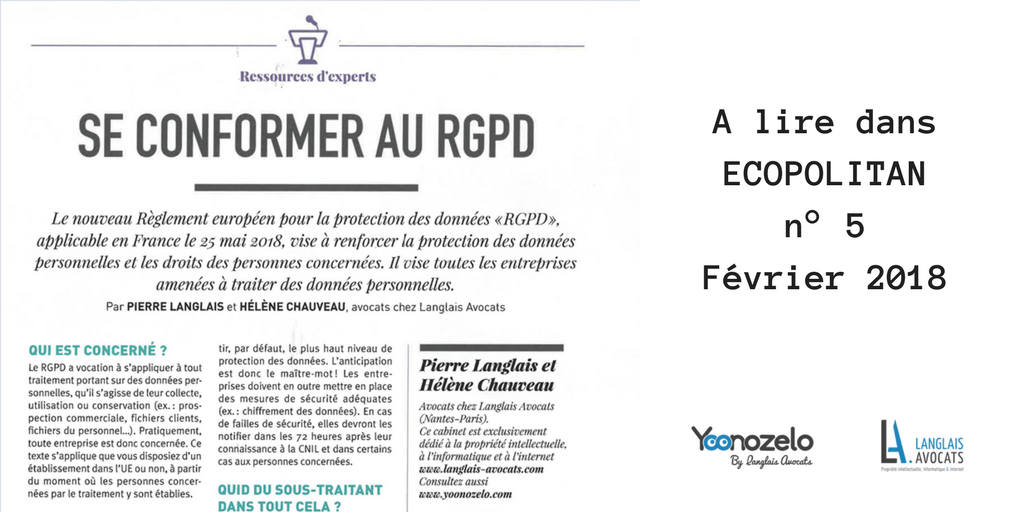Aux termes des articles L. 122-4 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont illicites tant la reproduction d’une marque enregistrée que d’un dessin protégé au titre du droit d’auteur. Dans un arrêt du 21 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris est venu apprécier l’illicéité de la reprise de l’image de SOPHIE LA GIRAFE et de son nom.
La société SOPHIE LA GIRAFE commercialise des jouets pour enfant, et notamment la girafe éponyme. Dans le cadre de ses activités, elle a déposé plusieurs marques, dont la marque semi-figurative française n°3 360 526 suivante :

La société A2GC CORPORATION est quant à elle spécialisée dans la vente de vêtements.
La société SOPHIE LA GIRAFE a assigné cette dernière en contrefaçon de ses marques et droits d’auteur à raison de l’apposition d’un dessin reproduisant, selon elle, le buste de son produit phare, sur des sweat-shirts.
S’agissant de la contrefaçon invoquée par la demanderesse de ses droits d’auteur sur la représentation de sa girafe, cette dernière présentait ainsi ses caractéristiques originales :
« une girafe debout légèrement de profil, son long coup et sa tête nous faisant face. […] SOPHIE LA GIRAFE nous regarde avec de grands yeux. Sa gueule est ouverte pour symboliser un large sourire. Deux cercles rouges ornent ses joues accentuant l’aspect chaleureux de l’animal. Deux oreilles pointues encadrant deux petites cornes forment comme une couronne au-dessus de sa tête ».
De son côté, la défenderesse indiquait en substance que la girafe représentée sur les vêtements en vente ne reprenait aucune des caractéristiques présentées comme originales par la demanderesse, le fait qu’elle ait une tête, deux oreilles et deux petites cornes étant tout à fait banal pour un tel animal.
Sur ce point, le Tribunal a suivi l’argumentaire de la société A2GC CORPORATION et considéré qu’il n’y avait pas contrefaçon, la représentation des oreilles et cornes étant fidèle aux attributs d’une girafe « réelle ».
S’agissant de la contrefaçon de marque invoquée par la demanderesse, reposant principalement sur la reprise querellée de la tête de la girafe ainsi que de son nom, elle a également été rejetée par le Tribunal, notamment sur les fondements suivants :
- la fonction essentielle de la marque : « la représentation d’une silhouette de girafe sur la quasi-totalité de la face avant d’un vêtement caractérise à l’évidence un usage que le public pertinent percevra exclusivement comme décoratif et non comme garantissant une origine commerciale ».
- l’absence de similarité des éléments figuratifs en cause : le Tribunal a en effet considéré que le buste de la girafe de la défenderesse ne reproduisait aucun « des détails dominants de la face » de l’animal de la demanderesse, ci-avant décrits.
Si le Tribunal a également rejeté la demande de la société SOPHIE LA GIRAFE sur le fondement de la concurrence déloyale, aucune situation de concurrence ne pouvant être caractérisée, il a en revanche condamné la société A2GC CORPORATION pour actes parasitaires, considérant que la référence au jouet bien connu de la demanderesse sur ses produits était une tentative de s’insérer dans son sillage pour bénéficier de sa notoriété.