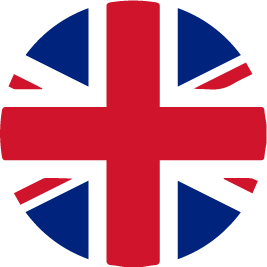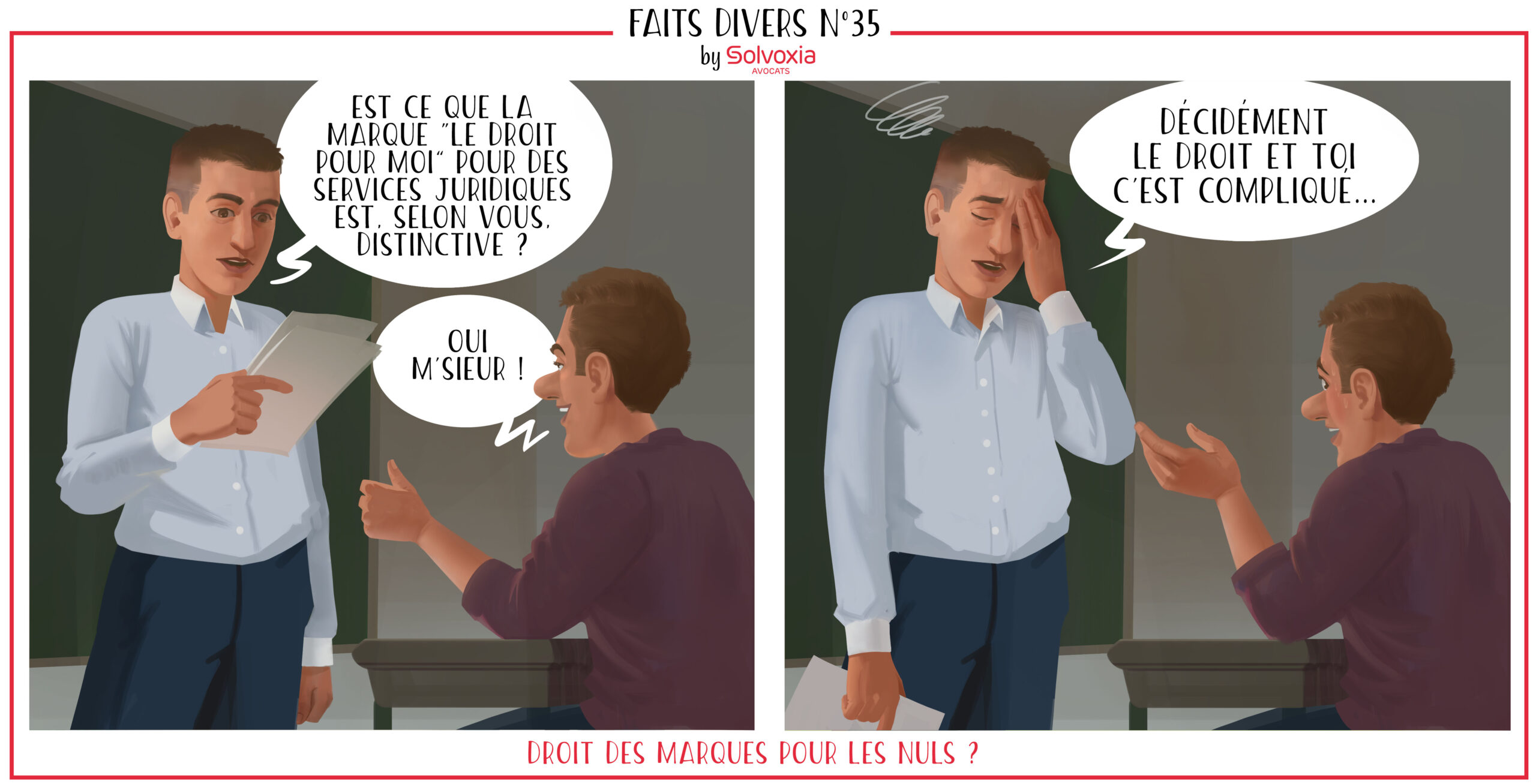Dans une décision du 4 juin 2025, l’EUIPO, l’Office européen pour la protection des marques notamment, a rejeté la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne « BOOKING.COM » pour des services en classes 35, 39, 41, 42 et 43.
Contexte : la demande d’enregistrement de la marque « BOOKING.COM » pour des services liés à la réservation d’hôtels en ligne
La société Booking.com a souhaité déposer la marque de l’UE « BOOKING.COM » pour les services qu’on lui connaît bien, à savoir globalement les services de réservation ainsi que les services annexes, notamment des services de publicité pour le voyage, de partage d’informations sur les voyages, déplacements, transports, etc., en classes 35, 39, 41, 42 et 43.
Après objection et après examen des observations du déposant, l’EUIPO a finalement refusé l’enregistrement de ladite marque.
Solution : le refus d’enregistrement de la marque « BOOKING.COM »
Le défaut de distinctivité du signe « BOOKING.COM » pour les services de réservation en ligne
L’Office a estimé que la marque « BOOKING.COM » était descriptive des services visés au dépôt et donc dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait en conséquence remplir les conditions de validité d’une marque.
Il a rappelé que ne pouvaient être enregistrées les marques composées de signes pouvant servir à désigner les produits ou les services proposés. Bien que le déposant ait tenté de se défendre en indiquant que personne n’utilisait le terme « booking.com » pour rechercher une plateforme qui fournit des services de réservation de voyages mais bien pour désigner sa société, l’Office a estimé que le signe était descriptif des services visés car pouvant être perçu dans sa signification, à savoir : « réservation en ligne ». Ainsi, les éléments composant le signe, à savoir « booking » et « .com », était purement, selon lui, descriptifs, « .com » permettant d’indiquer que les services visés peuvent être obtenus en ligne.
Le déposant arguait également du fait que la marque éponyme était enregistrée au niveau national dans plusieurs autres pays, ou sous forme figurative, mais l’EUIPO lui a rappelé qu’il n’était pas lié par les décisions rendues par les offices nationaux, et que la protection par la marque de l’UE est une protection autonome.
S’agissant des services visés, l’Office n’a pas examiné individuellement ceux-ci mais les a traités comme appartenant à une catégorie homogène plus large : il a considéré qu’ils étaient tous accessoires au domaine de la réservation en ligne.
En conclusion, l’Office a estimé que le signe était impropre à indiquer l’origine des services en cause.
Le refus de l’acquisition de la distinctivité par l’usage
Le déposant tentait par ailleurs de faire valoir que la marque « BOOKING.COM », si elle n’était pas distinctive à l’origine, avait acquis indubitablement une distinctivité par l’usage, tant elle était connue des consommateurs de l’UE.
Toutefois, l’Office a considéré que les preuves – bien que très étayées – fournies par le déposant (copies de sites internet, d’articles, de magazines, palmarès des marques connues dans certains pays, classement des meilleurs sites, utilisation massive du logo coloré, avis de clients, rapports, etc.) ne constituaient pas des preuves directes permettant de démontrer qu’une partie significative du public concerné, notamment à Malte et en Irlande (pays anglophones) et les pays dans lesquels le public possède une maîtrise suffisante de l’anglais, identifierait les services comme provenant de l’entreprise du demandeur. Il aurait fallu selon lui rapporter des éléments tels que les parts de marché, le chiffre d’affaires, des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou encore d’autres associations commerciales et professionnelles.
Pas suffisamment de preuves pour l’acquisition de la distinctivité par l’usage donc.
Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat droit des marques du cabinet.