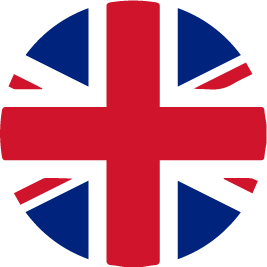La parodie, le pastiche ou la caricature sont des exceptions au droit d’auteur, qui empêchent l’auteur de l’œuvre parodiée, d’exercer son droit de l’autoriser ou de l’interdire. Dans un arrêt du 22 décembre dernier, la Cour d’appel de Paris a considéré que la reproduction partielle d’une œuvre dans un photomontage n’était pas une contrefaçon car il s’agissait, en l’espèce, d’une parodie.
Le sculpteur Alain Gourdon, auteur du buste de Marianne sous les traits de Brigitte Bardot est décédé en février 2014.
La SEBDO, société d’exploitation de l’hebdomadaire « Le Point », a publié quelques mois plus tard un numéro comportant en première de couverture un photomontage reproduisant partiellement l’œuvre d’Alain Gourdon.
Son épouse, titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre, dévolus dans le cadre de la succession de son mari, a assigné la société SEBDO devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire constater la reproduction contrefaisante.
Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la défunte, en se fondant sur l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle qui autorise « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » d’une œuvre divulguée et sur la liberté d’expression.
Pour rejeter l’argumentaire de la défunte, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le photomontage ne reproduisait que partiellement le buste de la Marianne, et le représentait délibérément dans une posture inhabituelle (immergé dans l’eau et en danger de noyade), dans le but de provoquer la réaction des lecteurs. Le Tribunal en a conclu que la reproduction de l’œuvre était une parodie, et que le photomontage « ne suscitera aucune confusion chez le lecteur avec l’œuvre première parodiée ».
La défunte de Monsieur Gourdon a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 décembre dernier, a confirmé le jugement de première instance.
Elle est venue en premier lieu préciser qu’une parodie « doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée et permettre l’identification de celle-ci ».
Appliqué au cas d’espèce, elle a considéré que « la représentation d’un emblème de la République française, immergé tel un naufragé, constitue une illustration humoristique, indépendamment des propos eux-mêmes et de leur sérieux ».
Au surplus, elle est venue souligner que la reproduction a été ponctuelle, limitée à un seul numéro aujourd’hui écoulé.
Au regard de ce qui précède, la contrefaçon de droits d’auteur n’a donc pas été retenue.