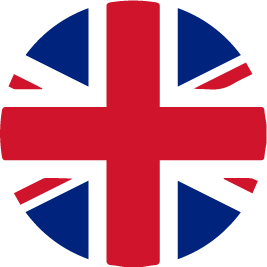Pour une entreprise, il est essentiel d’être au clair sur la question de savoir qui est titulaire des droits sur les créations qu’elle fait réaliser en interne pour ses propres besoins et/ou en externe pour ses clients (ex : logo, logiciel, catalogue, site internet, plaquette commerciale, etc.). Nous vous proposons un petit tour d’horizon des règles en la matière.
Le principe : l’auteur est titulaire des droits sur ses créations
Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L.111-1) pose le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Les droits d’auteur naissent donc, par principe, sur la tête de l’auteur dès l’origine (ex : salarié, freelance, etc.), à condition bien entendu que la création soit originale.
Il n’a aucune formalité à accomplir, par exemple auprès de l’Institut National pour la Propriété Intellectuelle (INPI) pour en bénéficier, contrairement par exemple en matière de marques ou de brevets où un dépôt est nécessaire.
Cela signifie concrètement que si vous êtes par exemple une agence de communication qui crée des logos au quotidien pour ses clients, les droits sur ces créations ne vous sont pas automatiquement dévolus. Il faut ainsi formaliser une cession des droits de votre salarié à votre profit, pour ensuite être en capacité le cas échéant de les céder à votre tour à vos propres clients.
Cela signifie également que si vous faites travailler un freelance ou une entreprise tierce pour un travail créatif, du type dessin d’étiquettes, réalisation d’une plaquette commerciale ou encore création d’un logo, il faudra vous assurer de vous faire céder les droits sur ce travail, pour être en capacité de l’exploiter pleinement et éventuellement à l’avenir de le modifier ou faire modifier à votre convenance.
Comment faire en pratique ?
Contrairement à ce qui pourrait être pensé, le paiement du prix d’une prestation ou le paiement du salaire à son salarié créateur n’emporte pas de cession à votre profit.
Il faut donc idéalement formaliser entre les parties une cession de droits d’auteur écrite, respectant un formalisme particulier à peine de nullité (notamment lorsque le cédant est le créateur et est une personne physique).
Le principe est le suivant : tout ce qui n’est pas prévu clairement par la cession n’est pas compris. La cession devra en conséquence mentionner chaque droit cédé (par exemple, reproduire la création sur différents supports physiques, la représenter dans le cadre d’un spot publicitaire à la télé, la modifier soi-même ou la faire modifier par une autre personne que le créateur), la durée de la cession (pour la durée des droits d’auteur à savoir 70 ans après le décès de l’auteur ou pour une durée plus courte), etc.
Si la cession n’est pas bien calibrée et que la création est exploitée au-delà de ce qui est prévu, il s’agira potentiellement d’actes de contrefaçon.
À cet égard, il faut noter que le Code de la Propriété Intellectuelle interdit toute cession globale des œuvres futures. Il n’est donc pas possible, en principe, de céder des droits à l’avance sur une œuvre qui n’existe pas encore, sauf à ce qu’elle soit individualisée et déterminable.
On évitera donc dans les contrats de travail les formulations « râteau » du type « toutes les créations réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat seront la propriété de la société ».
Il en va de même lorsque l’on travaille avec un tiers à l’entreprise sur le long terme qui aura vocation de produire plusieurs créations.
Mieux vaut alors préparer un contrat cadre qui prévoit la réitération des termes de la cession de manière périodique, par exemple en cas de prestataire tiers, via une mention spécifique dans les factures éditées par ce dernier en fin de chaque mission.
Deux exceptions au principe : l’œuvre collective et les logiciels
À chaque principe ses exceptions et le droit d’auteur n’échappe pas à la règle…
En matière logicielle tout d’abord, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que lorsqu’une personne est employée pour réaliser des développements informatiques, alors les droits sur ces développements appartiennent à l’employeur. Pas de cession nécessaire en pareil cas.
En ce qui concerne ensuite les œuvres à l’élaboration desquelles plusieurs personnes sont intervenues sans que l’on ne puisse individualiser leurs contributions respectives, sous la houlette d’une personne physique ou morale qui en prend l’initiative, les publie/les divulgue sous son nom, elles sont la propriété de cette dernière. Il s’agit de ce que l’on appelle les œuvres collectives. Ce pourra par exemple être le cas de dictionnaires ou magazines écrits à plusieurs mains. Dans de telles hypothèses, il est important de pouvoir documenter le caractère collectif du processus créatif, par exemple des guidelines à l’appui.
Et pour les inventions de salariés ?
Attention à ne pas confondre créations et inventions, ces dernières relevant de la protection par le brevet et d’un régime plus favorable à l’entreprise.
En résumé, lorsqu’une invention technique potentiellement brevetable est réalisée par un salarié dans le cadre de son emploi selon son contrat de travail, la société dispose du droit de déposer le brevet, sous réserve du règlement d’une contrepartie.
Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? Un avocat droit d’auteur est à votre disposition !