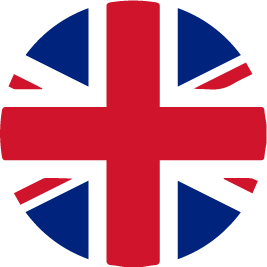La Cour d’appel de Versailles a, par décision du 26 novembre 2020 (n°20/00480) tranché un conflit opposant deux marques figuratives portant sur des emballages de fromages.
Contexte :
Le 1er avril 2019, l’Union laitière Vittelloise a déposé la marque française n°4539007 en classe 29 pour des « fromages » :
La société SAVENCIA a formé opposition à la demande d’enregistrement précitée, sur la base de sa marque française n°4212361 suivante, visant notamment les « fromages » en classe 29 :
Sa démarche n’ayant pas été couronnée de succès, la société SAVENCIA a formé appel de la décision du directeur général de l’INPI, rejetant l’opposition, devant la Cour d’appel de Versailles.
Solution :
La Cour d’appel de Versailles, pour débouter la société SAVENCIA de ses demandes, notamment souligné ce qui suit :
- Les marques consistent toutes deux dans un emballage de fromage en forme de fleur, dont le nombre de pétales est cependant différent,
- La présence commune d’un morceau de fromage découpé sur le dessus des emballages et la couleur ocre de ces derniers est très classique en matière de fromage de sorte que les différences tenant notamment à la présence de l’étiquette avec des éléments verbaux dans la demande d’enregistrement querellée et au liseré brun et l’étiquette verte de la marque antérieure confèrent aux signes une impression visuelle d’ensemble distincte,
- Les éléments verbaux de la marque opposée la distinguent phonétiquement du signe antérieur, qui n’en contient que quelques un quasiment illisibles,
- La demande d’enregistrement renvoie à l’idée de fraicheur, évocation absente de la marque antérieure, ce qui distingue les signes conceptuellement, quand bien même ils auraient tous deux une forme de fleur.
- Les preuves apportées par l’opposante pour démontrer que sa marque dispose d’une notoriété ne font état que de la notoriété du nom « Saint Albray » et non de l’élément figuratif protégé.
Résumé :
En matière de marque figurative, l’appréciation du risque de confusion n’est pas aisée et il est toujours bon de savoir que toutes les mentions figurant dans le dépôt seront prises en compte dans l’appréciation de ce risque, notamment d’éventuels éléments verbaux et petits visuels graphiques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.