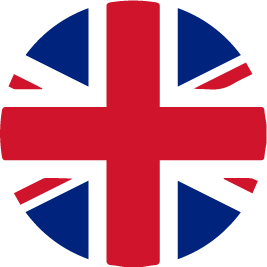Intervention le 11 décembre 2015 du cabinet sur les inventions de salariés lors des Journées de la Propriété Intellectuelle de l’Ouest (JPIO).
Le cabinet dans la revue Propriété Industrielle
Pierre LANGLAIS et Déborah DAYAN publient un article sur « saisie-contrefaçon : points de vigilance – Panorama de jurisprudence (juin 2013 – septembre 2014) » dans la revue Propriété Intellectuelle N°11 – novembre 2015.
Le cabinet partenaire des 20 ans du master 2 Propriété Intellectuelle de l’université de Nantes
Le cabinet partenaire le 8 septembre 2015 des 20 ans du Master 2 Propriété Intellectuelle de l’Université de Nantes.
Licence de logiciel : nullité de la clause interdisant le transfert d’un logiciel sur une nouvelle machine
Alors que nombre de logiciels-métier ont vocation à être exploités sur plusieurs années, l’éditeur peut-il légitimement interdire à ses clients de transférer un logiciel d’une machine à une autre ? La Cour d’appel, sollicitée sur ce point, donne un éclairage sur l’impact de la modification de l’environnement informatique sur le périmètre d’un contrat de licence.
Deux sociétés ont conclu un contrat de licence d’utilisation de logiciel, prévoyant que l’exploitation se ferait sur une unité centrale et un système d’exploitation donnés, avec la possibilité d’une seconde utilisation à des fins de sauvegarde et de tests. Le contrat prévoyait également la maintenance du logiciel par le concessionnaire.
La société cliente a, au cours du contrat, changé à plusieurs reprises d’unité centrale, réinstallant donc le logiciel sur son matériel le plus récent. Le prestataire, estimant que sa cliente exploitait le logiciel en dehors du périmètre de la licence concédée, a demandé à cette dernière le règlement d’arriérés. Aucun accord n’ayant été trouvé, le prestataire a assigné sa cliente aux fins de résiliation du contrat et de condamnation de cette dernière au règlement d’arriérés de redevance.
Le prestataire considérait que sa cliente, en modifiant son environnement informatique, ne respectait plus les termes initiaux de son contrat de licence au sein duquel étaient déterminés un type d’unité centrale et un système d’exploitation. Le prestataire invoquait une différence de prix selon la puissance l’unité centrale utilisée pour motiver sa demande.
La société cliente ne contestait pas avoir changé d’environnement informatique mais faisait valoir que de telles modifications n’entraient pas en contradiction avec les termes de la licence consentie et que son prestataire était par ailleurs parfaitement informé de cet état de fait.
Dans son arrêt du 7 mai 2015, rendu sur renvoi de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du prestataire. En effet, la Cour considère que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat n’était pas de lier le logiciel à une machine donnée et que la présence d’une clause, au sein d’un contrat de licence de logiciel, ayant pour effet de limiter l’utilisation du logiciel concédé, aurait en tout état de cause été entachée de nullité.
La cour d’Appel de Paris préfère les burgers aux pizzas : la marque Giant validée
Par un arrêt du 14 avril 2015, la Cour d’appel reconnait la distinctivité de la marque GIANT, supprime la marque de son concurrent, puis prononce la condamnation de ce dernier sur le terrain du droit des marques ainsi que sur le terrain de la concurrence déloyale.
La société QUICK est titulaire de la marque internationale GIANT, désignant notamment les classes de produits alimentaires, depuis 2006. En 2011, la société SODEBO a déposé, pour des produits identiques, la marque « PIZZA GIANT SOBEBO ». Estimant que cette marque portait atteinte à ses droits, la société QUICK a assigné SODEBO en contrefaçon et en concurrence déloyale. En retour, SODEBO invoquait la nullité de la marque « GIANT » pour défaut de distinctivité.
Pour justifier sa demande de nullité, SODEBO prétendait que la marque GIANT était descriptive car mettait en exergue les qualités du produit proposé sous cette marque. Les premiers juges ont donné raison à la société SODEBO et ont prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT », considérant que cette dernière n’était pas distinctive, le terme « GIANT » étant largement compris du public français comme signifiant « géant » ou « énorme », ce qui était descriptif des caractéristiques des produits et n’était dès lors pas distinctif. La société QUICK a fait appel de cette décision et la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 14 avril 2015, devait donc se prononcer sur la distinctivité de la marque « GIANT ».
La Cour d’appel est venue infirmer le jugement du TGI et a considéré que la marque « GIANT » était arbitraire et distinctive et conférait « une image positive à ses produits et services », sans informer directement le consommateur de l’une de leurs caractéristiques.