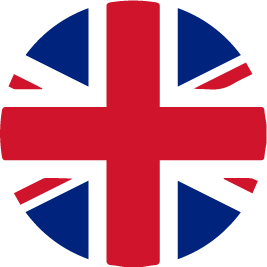Dans une décision du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a eu à se prononcer sur la protection par le droit d’auteur d’une police de caractères et sur les conséquences de son utilisation commerciale par des sociétés tierces.
Contexte : La reprise d’une typographie à des fins commerciales
Un dessinateur, graphiste et créateur de police de caractères commercialisait en ligne plusieurs polices, dont l’une intitulée « Lethal Slime », au style horrifique.
Dans le cadre d’un partenariat commercial, des sociétés espagnoles spécialisées dans la vente de produits capillaires avaient déposé une marque de l’Union européenne semi-figurative « My Monster Slime » et utilisé ce logo à des fins promotionnelles.
Or, constatant la reprise dans cette marque de sa police « Lethal Slime », sans son autorisation, son créateur avait mis en demeure les sociétés concernées de cesser cet usage et de l’indemniser du préjudice subi, puis les avait assignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Solution : La reprise d’une police de caractères originale sanctionnée par la contrefaçon
L’originalité d’une police de caractères reconnue
Le tribunal se penche d’abord sur la question de l’éligibilité de la police de caractères à la protection par le droit d’auteur, ce qui suppose la démonstration de son originalité. Il rappelle tout d’abord que les œuvres graphiques et typographiques peuvent constituer des œuvres de l’esprit protégées, dès lors qu’elles traduisent des choix libres et créatifs de leur auteur.
Contrairement à ce que soutenaient les défenderesses, à savoir que la conception d’une police de caractères ne suppose pas un effort créatif particulier, qu’elle pouvait être créée à partir de logiciels accessibles sans requérir de technique particulière, qu’elle s’inspire de typographies déjà présentes en ligne, le tribunal rejoint la démonstration de l’originalité opérée par le demandeur, à savoir que le parti-pris esthétique réside dans la combinaison de diverses particularités graphiques (style horrifique, aspect visqueux des lettres, délimitation tortueuse et irrégulière, certaine épaisseur, délimitation noire et un intérieur blanc, etc.).
Ces choix créatifs étaient en outre corroborés par la production d’une planche manuscrite de dessins, démontrant un véritable travail préparatoire.
Le tribunal conclut ainsi à l’originalité de la police de caractères.
Des actes de contrefaçon caractérisés
Dans un second temps le tribunal examine la caractérisation des actes de contrefaçon.
Il était reproché aux défenderesses l’usage à des fins commerciales de la police de caractère, notamment dans le logo apposé sur leur gamme de shampoings, sous forme de dépôt de marque, sur leurs pages Facebook et Youtube destinées à la promotion desdits produits, sur les visuels d’un jeu édité par elles.
Le dessinateur démontrait par ailleurs que le site de téléchargement précisait explicitement : « Cette police est gratuite pour un usage personnel. Pour toute utilisation commerciale, contactez-moi ».
Le tribunal retient finalement que les défenderesses ont reproduit la police de caractères litigieuse dans l’exercice de leur activité commerciale sans autorisation, acte constitutif de contrefaçon. Il constate également l’atteinte au droit moral de l’auteur puisque l’usage a été réalisé sans mention de sa paternité.
En conséquence, bien que le chiffre d’affaires généré au titre de la vente des produits ne puisse être établi, les juges retiennent que cet usage a permis aux défenderesses de faire l’économie d’investissements matériels et créatifs et a nécessairement engendré un manque à gagner financier pour l’auteur. Ils les condamnent donc à 6.000 euros au titre de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de l’auteur et à 1.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet.