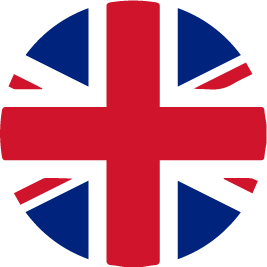Dans une décision du 23 juin 2021 (n°19/18111), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de modèles, il appartient au juge de rechercher si le modèle incriminé produit, sur l’observateur averti, une impression visuelle globale identique ou différente.
Contexte :
Une société commercialisait une gamme de verres à pied. Un verre avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire ainsi que d’un dépôt de modèle international visant la France.
Considérant que l’un de ses concurrents commercialisait une gamme de verres à vin qu’elle jugeait contrefaisants, elle l’a assigné en contrefaçon de ses modèles, de droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
La Cour d’appel avait retenu comme caractérisés les faits de contrefaçon en constatant notamment, s’agissant des modèles, l’existence d’une impression visuelle globale d’identité des pieds respectifs des verres en cause.
Solution :
La Cour de cassation, dans sa décision, a relevé que les modèles déposés par la société demanderesse portaient sur un verre à pied et non uniquement sur la jambe dudit verre.
De ce fait, les juges du fond ne pouvaient se cantonner à apprécier l’impression visuelle générée chez l’observateur pour les verres en cause au regard seulement de leur pied et aurait dû rechercher si ces verres produisaient, dans leur globalité, une même impression visuelle.
Résumé :
Pour apprécier la contrefaçon de modèles il est nécessaire de prendre en compte l’impression visuelle d’ensemble des produits en cause et non pas seulement l’impression visuelle qu’ils génèrent pour certains de leurs éléments caractéristiques. L’appréciation de la contrefaçon d’un verre à pied ne pourra donc être réduite à l’impression visuelle identique dégagée par son pied si le modèle porte sur le verre entier !
Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.