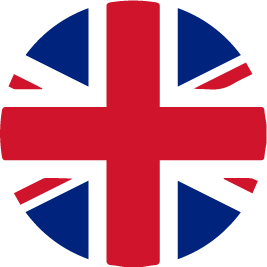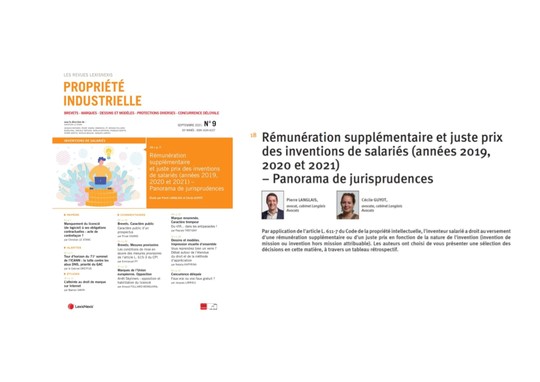Dans une décision du 9 septembre 2021 (C-783/19), la Cour de justice de l’Union Européenne a apporté des précisions très intéressantes sur l’étendue de la protection conférée par une appellation d’origine protégée.
Contexte :
Une société exploite le signe « CHAMPANILLO » pour des bars à tapas en Espagne, en y associant dans ses supports publicitaires une image de deux coupes remplies de boisson mousseuse.
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), estimant que l’usage de ce signe portait atteinte à l’appellation d’origine protégée « Champagne », a saisi le juge espagnol afin d’ordonner à la société en question toute utilisation du terme « Champanillo ».
Débouté en première instance, il a fait appel, et la juridiction de recours a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant à la fois sur l’étendue de la protection conférée par une AOP et sur les modalités concrètes pour apprécier une atteinte à un tel droit.
Solution :
La première question posée à la Cour tenait au fait que le signe « Champanillo » ne visait que des services de restauration mais pas de produits.
La Cour répond que, bien qu’une AOP ne puisse viser que des produits, en revanche la protection très large dont elle bénéficie permet d’empêcher toute utilisation de l’AOP tant pour des produits que des services, dans la mesure où il est parfaitement possible de chercher à bénéficier de la réputation d’un tel droit pour des services.
Les questions suivantes portaient sur l’étendue de la protection conférée, qui permet notamment de s’opposer à « toute usurpation, imitation ou évocation » de l’AOP.
La Cour précise que, pour qu’il y ai évocation, il suffit que le consommateur établisse un lien, direct et univoque, entre le terme utilisé et l’AOP en question, sans nécessité que les termes soient utilisés pour des produits et/ou services identiques ou similaires.
Dès lors, bien qu’il n’y ait que peu à voir entre un restaurant de tapas et une bouteille de champagne, la Cour invite le juge espagnol à se demander si, d’un point de vue global, un consommateur confronté au signe « Champanillo » n’y verrait pas une allusion au célèbre mousseux.
Enfin, le juge européen rappelle que le régime de protection des AOP n’est pas exclusif de la concurrence déloyale, et que dès lors un même comportement peut être à la fois une pratique interdite du point de vue du droit des AOP et un acte de concurrence déloyale.
Résumé :
Les AOP bénéficient donc d’une protection particulièrement large, destinée à protéger le consommateur, et permettent d’empêcher des tiers d’utiliser des signes approchant même pour des produits et/ou services très différents.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.