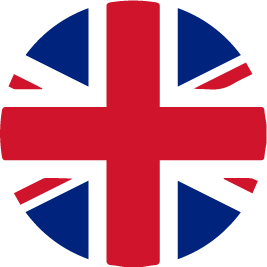Le Tribunal de l’Union Européenne a pu, le 21 avril 2021, se prononcer sur la conformité au droit européen de la pratique consistant à redéposer régulièrement une même marque, en vue d’éviter d’avoir à rapporter la preuve d’un usage sérieux de sa marque.
Contexte :
La société Hasbro est titulaire de plusieurs marques MONOPOLY, protégeant le nom de ce célèbre jeu de plateau pour divers produits et services. En 2010, elle a demandé l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union Européenne éponyme, pour des produits et services pour lesquels elle bénéficiait déjà d’une protection via ses autres marques.
Si un tel dépôt pourrait paraître à première vue superflu, il s’agit en réalité d’une stratégie juridique visant à faciliter l’exploitation juridique de ses marques.
En effet, lorsqu’une marque est enregistrée depuis plus de 5 ans, et que son titulaire l’utilise contre un tiers, notamment via une action en contrefaçon ou une opposition à l’enregistrement d’une marque proche, le tiers peut se défendre en demandant à ce que le titulaire de la marque justifie qu’il exploite sérieusement sa marque.
Pendant les 5 premières années suivant son enregistrement, une marque bénéficie ainsi d’un « délai de grâce », durant lequel il n’est pas imposé qu’elle fasse l’objet d’un usage sérieux.
En redéposant sa marque de manière régulière, la société Hasbro cherchait donc manifestement – sans s’en cacher d’ailleurs – à renouveler ce délai de grâce, de manière à pouvoir en bénéficier indéfiniment.
Une autre société, qui commercialisait un jeu de société DRINKOPOLY, alternative festive du jeu de plateau original, a agit en nullité de la nouvelle marque de la société Hasbro, estimant qu’elle avait été déposée de mauvaise foi.
L’Office européen a fait droit à cette demande et prononcé la nullité de la marque, et Hasbro a formé un recours contre cette décision.
Solution :
Le Tribunal rappelle qu’un dépôt de marque peut être considéré de mauvaise foi lorsqu’il a été fait non pas en vue de participer de manière loyale au jeu concurrentiel, mais de porter atteinte aux usages commerciaux, aux intérêts de tiers, ou de bénéficier d’un droit exclusif n’ayant pas pour but d’indiquer aux consommateurs l’origine des produits et services.
Si tout déposant est considéré en principe comme de bonne foi, en présence de circonstances laissant planer un doute sur ses intentions lors du dépôt il lui appartient de démontrer qu’il n’était pas de mauvaise foi.
Ici, la cour relève que, si le dépôt répété d’une même marque n’est pas interdit par principe, il est caractéristique de la mauvaise foi lorsque – des termes mêmes du déposant – il est réalisé pour éviter d’avoir à prouver un usage sérieux de ses marques.
Et peu importe, selon le Tribunal, qu’il s’agisse d’une pratique courante, parfois conseillée par des avocats, ni que le dépôt ne soit pas réitéré précisément tous les 5 ans.
La nullité de la marque, déposée de mauvaise foi, est dès lors confirmée.
Résumé :
Redéposer une marque en vue de s’épargner la preuve d’un usage sérieux est caractéristique d’un dépôt de mauvaise foi et la marque encourt donc la nullité. En l’occurrence, en repassant par la case « Dépôt », Hasbro n’a pas touché le pactole escompté mais a été envoyé directement à la case « Nullité » !
Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA.