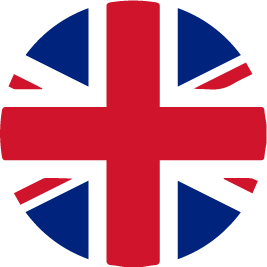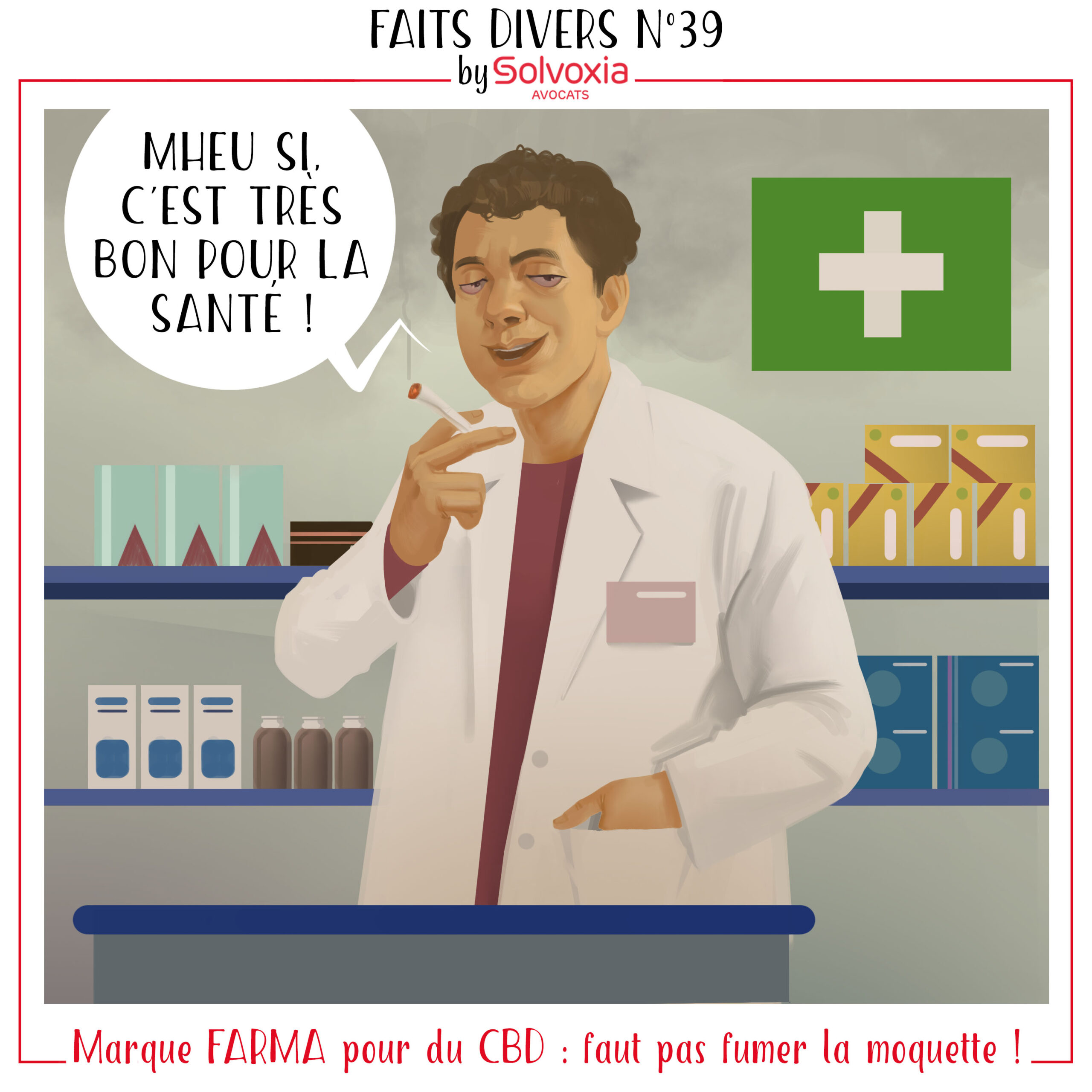
Dans une décision du 18 juin 2025 (n°23/07390), la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur une question mêlant propriété intellectuelle et protection du consommateur : l’usage du terme « FARMA », associé à une croix grecque dans une marque commerciale liée au CBD, constitue-t-il une tromperie sur l’origine ou la nature pharmaceutique des produits ?
Contexte : La nullité de la marque FARMA CBD PREMIUM sollicitée pour motif absolu
Tout commence par le dépôt, le 14 février 2022, de la marque semi-figurative française « FARMA CBD PREMIUM » par la société FARMA, désignant notamment des fleurs naturelles, articles pour fumeurs, solutions liquides pour cigarettes électroniques et briquets pour fumeurs.
La marque comportait un élément figuratif : une croix grecque inscrite dans un cercle, sur laquelle apparaissait en grands caractères le mot « FARMA » et en partie basse du cercle, les termes « CBD PREMIUM ».
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), estimant que ce signe évoquait abusivement le monde de la pharmacie, a saisi l’INPI d’une demande en nullité pour caractère trompeur.
L’argument : le consommateur risquait de croire, à tort, que les produits en cause bénéficiaient d’une caution pharmaceutique ou provenaient d’un professionnel de santé. Le CNOP considérait également qu’il y avait contrariété avec l’ordre public sanitaire puisque le signe laissait croire au public que les produits auraient des vertus thérapeutiques ou bienfaisantes alors qu’ils sont nocifs.
L’INPI a rejeté cette demande en mars 2023, considérant que le public ne serait pas susceptible d’être induit en erreur.
Un recours a donc été formé devant la Cour d’appel de Paris.
Solution : La nullité retenue
1️⃣ Une marque trompeuse : le public induit en erreur
La Cour d’appel a commencé par rappeler le cadre légal : selon l’article L.711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être enregistrée si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits.
Or, ici, les éléments visuels – en particulier la croix grecque – et dénominatifs de la marque “FARMA CBD PREMIUM” entretenaient selon les juges une confusion manifeste avec le domaine pharmaceutique.
- La croix grecque — même stylisée — reste un emblème officiel de la profession, expressément prévu par l’article R.4235-53 du Code de la santé publique pour signaler les officines de pharmacie.
- Le mot « FARMA », proche phonétiquement et visuellement du radical “pharma”, renvoie immédiatement à la pharmacie dans l’esprit du public.
Le consommateur moyen, en voyant ce logo sur des produits contenant du CBD, serait donc tenté de penser qu’ils proviennent d’un acteur du secteur pharmaceutique ou qu’ils bénéficient d’une forme de garantie médicale.
2️⃣ Les autres griefs, secondaires, ne sont pas examinés
La Cour, après avoir constaté cette tromperie, n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres moyens du CNOP (contrariété à l’ordre public et mauvaise foi).
Elle a donc infirmé la décision de l’INPI et prononce la nullité de la marque “FARMA CBD PREMIUM” dans son intégralité.
La société déposante a été condamnée à verser 3 000 euros au CNOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans condamnation aux dépens, conformément aux règles applicables aux recours contre les décisions de l’INPI.
En résumé, attention lorsque vous envisagez de déposer une marque qui évoque l’univers du soin, à ne pas emprunter les codes de la pharmacie pour inspirer de manière trompeuse, confiance au consommateur.
Vous voulez creuser le sujet ? Prenez attache avec un avocat droit des marques du Cabinet.