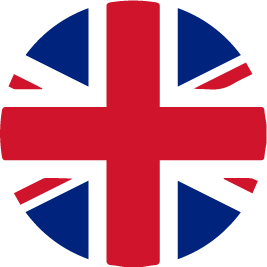Dans une décision du 7 juillet 2021 (T-668/19), le Tribunal de l’Union Européenne a dû se prononcer sur l’enregistrement d’une marque sonore imitant l’ouverture d’une canette.
Contexte :
La société Ardhag, fabricante de conteneurs en verre et métal et notamment de canettes, a demandé en juin 2018 l’enregistrement d’une marque visant divers produits tenant aux boissons et à leurs conteneurs.
La particularité de cette marque est qu’elle était sonore : on y entendait donc le son familier de l’ouverture d’une canette, suivi d’une seconde de silence puis d’une dizaine de secondes de bulles qui pétillent.
L’enregistrement a néanmoins été refusé, pour défaut de distinctivité, et la déposante a formé un recours.
Solution :
Pour être distinctif, un signe doit pouvoir être perçu par le consommateur comme une indication d’origine des produits et services et différencier ces derniers de ceux d’une autre entreprise. Et ce, comme le rappelle le Tribunal, quelle que soit la forme de la marque !
Or, le son en cause serait immédiatement perçu par un consommateur comme le son émit par une canette à son ouverture, et est donc inhérent aux produits visés par la demande de marque.
Dès lors, le signe sonore ne serait perçu que comme un simple élément fonctionnel, et n’est pas distinctif, car le consommateur qui entendrait ce son n’en déduirait pas qu’il identifie une marque.
L’absence de distinctivité est donc confirmée par le Tribunal, et ce y compris pour des boissons non gazeuses (qui ne pétillent donc pas).
Le Tribunal rappelle toutefois qu’une marque sonore n’est pas une marque tridimensionnelle : dès lors, la jurisprudence propre à ces marques « de forme » qui tend à rejeter la distinctivité de formes courantes et habituelles sur le marché concerné, n’était pas applicable ici.
Résumé :
Comme toute marque, un son doit être distinctif pour être protégé, c’est-à-dire pouvoir être compris par consommateur comme l’identification de l’origine de produits et services. Tel n’est pas le cas d’un son purement fonctionnel, par exemple l’ouverture d’une canette et le pétillement de bulles pour des boissons.
Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA.