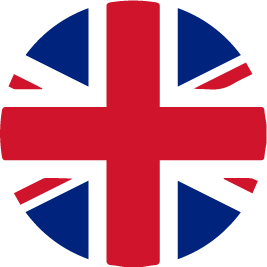Dans une décision du 2 avril 2021 (CA Paris, 2 avr. 2021, n°19/03350), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la qualification d’une invention de mission et la rémunération supplémentaire découlant de cette qualification.
Contexte :
En l’espèce, un salarié était intervenu sur trois inventions ayant fait l’objet, suite à son licenciement, d’une déclaration auprès de la société venant aux droits de son employeur.
La Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) avait été saisie, ayant par la suite considéré qu’une seule des trois inventions était brevetable et formulant ainsi une proposition pour une rémunération supplémentaire à hauteur de 4 000 euros.
Le salarié, considérant que les trois inventions sur lesquelles il était intervenu devaient être qualifiées d’inventions hors mission attribuable, a saisi la justice aux fins d’obtenir notamment paiement d’un juste prix.
Solution :
La Cour d’appel de Paris a refusé de qualifier les trois inventions d’inventions hors mission attribuable. En effet, la fiche de poste du salarié inventeur précisait clairement qu’il devait concourir à l’amélioration de la sûreté des moyens de production, réduire les pannes et dans ce cadre faire preuve d’un esprit « inventif ». Selon les juges du fond, cela démontrait l’existence d’une activité inventive et emportait donc la qualification d’invention de mission.
Par ailleurs, le salarié lui-même, dans ses déclarations d’invention adressées à son employeur, avait indiqué que ces dernières avaient été réalisées dans le cadre de son contrat de travail qui impliquait une activité inventive correspondant, selon lui, à ses fonctions effectives.
La juridiction d’appel a par ailleurs confirmé que seule l’une des trois inventions était effectivement brevetable et pouvait donc ouvrir droit au paiement d’une rémunération supplémentaire.
Cette dernière n’ayant cependant pas été brevetée, et ni son intérêt économique ni son exploitation n’ayant été démontrés, les juges du fond ont conclus que c’est à raison que les premiers juges avaient considéré qu’une rémunération supplémentaire de 152 euros devait lui être versée, conformément à ce qui était prévu dans son contrat de travail du salarié.
Résumé :
Avant d’initier une action en paiement d’un juste prix pour une invention hors mission attribuable, toujours bien vérifier que notamment ni le contrat de travail, ni les échanges écrit entre les parties évoquent une mission inventive dévolue au salarié. A défaut, les chances de succès risquent d’être limitées.
Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA.