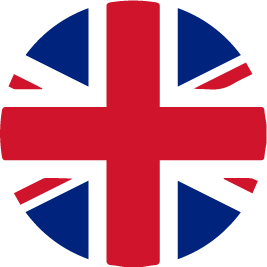Dans une décision du 19 janvier 2026, la chambre des recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur la distinctivité de la marque de l’UE « À JAMAIS LES PREMIERS ».
Contexte : Le dépôt d’un slogan sportif à titre de marque de l’UE
La société Limoges CSP a déposé, le 2 avril 2025, la marque verbale de l’Union européenne « À JAMAIS LES PREMIERS » pour désigner de nombreux produits et services couvrant un large éventail de classes.
Selon elle, ce slogan faisait directement référence à un fait marquant de l’histoire du sport français : la victoire du Limoges CSP en Coupe d’Europe en 1993, première remportée par un club français.
Après un premier refus provisoire de la demande par l’examinatrice de l’EUIPO, celle-ci a confirmé son refus, aux motifs notamment que, pour le consommateur francophone, le signe serait immédiatement compris comme un slogan auto-promotionnel élogieux, exprimant l’idée que les produits ou services proposés sont « les meilleurs » et le resteront « pour toujours », ne lui permettant pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.
La déposante a donc formé un recours contre cette décision devant la chambre des recours de l’EUIPO.
Solution : Un slogan, mais pas une marque distinctive
Une appréciation exigeante de la distinctivité des slogans
La chambre des recours rappelle, en premier lieu, que sont refusés à l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque : identifier l’origine commerciale des produits ou services.
Ainsi, un slogan élogieux se doit de remplir la condition de distinctivité pour bénéficier de la protection par le droit des marques : il ne doit pas être uniquement perçu comme une simple formule promotionnelle.
La déposante soutenait que l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » se distinguait par une construction inhabituelle et poétique la rendant mémorisable et distinctive.
À contrario, la décision de la chambre des recours confirme l’approche de l’examinatrice, à savoir que le slogan « À JAMAIS LES PREMIERS » sera compris littéralement comme « pour toujours les meilleurs », ce qui ne produit pas un impact suffisant pour permettre au consommateur d’y reconnaître une indication d’origine commerciale.
L’appréciation de la distinctivité par rapport aux produits et services désignés
Sur ce point, la chambre considère que le public pertinent percevra le signe non comme un signe distinctif mais comme un slogan promotionnel élogieux, traduisant un message valorisant aux termes duquel les produits et services concernés sont « les meilleurs » ou le resteront indéfiniment.
Il s’agit donc là d’une expression purement laudative pour les produits/services en cause.
Enfin, la déposante soulignait que ce slogan avait été accepté à l’enregistrement par l’INPI. Sur ce point, le fait que le signe ait été accepté par l’INPI est, assez classiquement, jugé inopérant : le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, indépendant des systèmes nationaux qui n’est pas lié par les Offices nationaux.
En conclusion, la chambre confirme que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » est dépourvu de caractère distinctif et rejette le recours.
Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat droit des marques du cabinet.